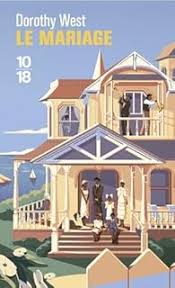
Tony Morrison, prix Nobel de littérature 1993, s’est beaucoup battue pour faire reconnaître les écrivaines Africaines-Américaines, jouant de sa notoriété pour détendre ces artistes. Les femmes sont enfouies dans des références masculines toujours mises d’abord en avant. Notre patrimoine est commun et ne peut être amputé de moitié et quelque fois plus de cette moitié.
Dorothy West a fait longtemps partie de cette cohorte. Comme le rappelle la traductrice Arlette Stroumza, elle commence pourtant à publier à 14 ans ses histoires dans des revues, au début du 20e siècle et participera, dans les années 20, au mouvement « Harlem Renaissance » aux côtés de Langston Hughes et de Zora Neale Hurston, redécouverte un temps par son autobiographie « Des pas dans la poussière », retournée dans l’ombre depuis.
En 1948, Dorothy West publiera « The Living is Easy » – non traduit en français – qui lui permettra d’avoir un début de visibilité.
Il a fallu l’entregent de sa voisine, Jacqueline Kennedy Onassis pour lui permettre d’éditer, au début des années 1990 ce roman : « Le mariage ». Elle prend pour objet une communauté spécifique d’Africains-Américains habitant.e.s dans une petite île, Martha’s Vineyard, sise près de Boston, et participants de la haute moyenne bourgeoisie, une population huppée. La fille qui se marie dans la famille Coles, Shelby, la cadette, est tombée amoureuse d’un saltimbanque au grand dam de sa mère et de son arrière grand-mère, un musicien de jazz, Meade, Caucasien comme on dit aux États-Unis, Blanc autrement dit. Première ironie de l’histoire, le jazz étant une musique noire par définition. Shelby, apparemment est « blanche » avec une chevelure blonde d’origine. Elle pourrait donc « passer la ligne » mais s’y refuse. Pour illustrer le racisme, les stéréotypes, les préjugés, l’autrice décrit une fugue dont, enfant de 4 ans, Shelby s’était rendue coupable. On la retrouva très tard parce que personne ne pouvait croire qu’elle était africaine-américaine. Du grand guignol inscrit dans la réalité de cette société américaine qui refuse de voir tous les brassages et leurs conséquences quant à la transformation des apparences.
Le projet de mariage provoque des réactions de toute la famille, manifestations racistes de tout côté, anti féministes. Un personnage, en dehors de la famille, fera son entrée pour signifier que la misogynie est la chose du monde la mieux partagée par les hommes quelque que soit la couleur de leur peau.
Roman plein de verve, d’ironie, d’humour sur une classe sociale qui n’arrive pas à se situer, à trouver sa place entre son patrimoine, sa position dans la société et la couleur de sa peau. La distance que permettent l’humour et l’ironie font de la saga familiale des Coles un monument de reconstruction de leur histoire racontée, enjolivée, détruite et réaménagée pour une présentation dans laquelle la réalité a peu à voir. Un grand moment d’écriture qui devrait faire accéder Dorothy West au panthéon de la littérature.
Nicolas Béniès
« Le mariage », Dorothy West, traduit par Arlette Stroumza, 10/18
Des militants partagent ici des critiques littéraires, musicales, cinématographiques ou encore des échos des dernières expositions mais aussi des informations sur les mobilisations des professionnels du secteur artistique.
Des remarques, des suggestions ? Contactez nous à culture@snes.edu
